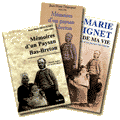Le métier de mendiant et la lutte contre le paupérisme selon Déguignet
Un article de GrandTerrier.
| Version du 7 septembre ~ gwengolo 2018 à 10:21 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 7 septembre ~ gwengolo 2018 à 13:52 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| Enfin, au bout de cinq à six semaines d'apprentissage, pensant connaître assez bien le métier, et trouvant que la vieille commère s'arrêtait trop longtemps dans certaines fermes, je pris le parti d'aller seul pour achever plus vite mes tournées hebdomadaires, car il était de règle de n'aller qu'une fois par semaine dans chaque ferme. | Enfin, au bout de cinq à six semaines d'apprentissage, pensant connaître assez bien le métier, et trouvant que la vieille commère s'arrêtait trop longtemps dans certaines fermes, je pris le parti d'aller seul pour achever plus vite mes tournées hebdomadaires, car il était de règle de n'aller qu'une fois par semaine dans chaque ferme. | ||
| - | Malheureusement, il ne faisait pas beau aller seul, surtout à mon âge, faible et timide comme j'étais. Il y avait une multitude de mendiants de tout âge, de véritables bandits, lesquels quand ils rencontraient un malheureux seul avec sa besace pleine, ne se gênaient pas pour la vider dans la leur, en tirant encore les oreilles au pauvre bougre par-dessus le marché. À moi, ils le firent trois ou quatre fois, et j'étais obligé de retourner à la maison à vide, où j'étais encore grondé par la mère parce qu'elle croyait qu'au lieu de mendier j'avais <ref name="Avoir">{{BR-Avoir}}</ref> resté jouer. ... | + | Malheureusement, il ne faisait pas beau aller seul, surtout à mon âge, faible et timide comme j'étais. Il y avait une multitude de mendiants de tout âge, de véritables bandits, lesquels quand ils rencontraient un malheureux seul avec sa besace pleine, ne se gênaient pas pour la vider dans la leur, en tirant encore les oreilles au pauvre bougre par-dessus le marché. À moi, ils le firent trois ou quatre fois, et j'étais obligé de retourner à la maison à vide, où j'étais encore grondé par la mère parce qu'elle croyait qu'au lieu de mendier j'avais <ref name="Avoir">{{BR-Avoir}}</ref> resté jouer. Oui, il y avait alors dans cette commune une douzaine d'individus faisant soi-disant le métier de mendiants mais qui, en réalité, n'étaient que des voleurs. deux surtout de ceux-là, les deux par lesquels je fus dévalisé plusieurs fois, étaient deux véritables gredins de la pire espèce. Il n'y avait pas de tour pendable, de canailleries dignes de la potence qu'ils ne jouassent aux fermiers et même à tout le monde à l'occasion. Ceux-là ne s'amusaient pas à dire leurs prière aux portes, ils ne les savaient, du reste. |
| - | Quand ils savaient qu'il n'y avait que des femmes ... | + | Quand ils savaient qu'il n'y avait que des femmes dans la maison, ce qui arrivait souvent à la campagne, les hommes étant presque toujours aux champs, ils entraient hardiment et allaient s'asseoir à la table, commandant aux pauvres femmes transies de peur, de leur donner à manger ou gare le <i>penbas</i> <ref name="Penn-Baz">{{BR-Penn-bazh}}</ref>. Et il ne faisait pas beau discuter ou disputer avec ces coquins car, s'ils ne savaient pas leurs prières ; en revanche ils connaissaient sur le bout des doigts le dictionnaire pornographique, voyoucratique et stercocaire breton. Lord Semour, Mylord l'Arsouille <ref>Lord Seymour (1805-1859), qui introduisit en France le jet de confetti, fut baptisé Milord l'Arsouille par les parisiens, à cause de son exentricité.</ref>, le roi des voyous qui vivait en ce temps-là, aurait été roulé par ces deux bandits bretons. Quand ils ne trouvaient personne dans les fermes, ils entraient quand même, soit par la porte, soit par la fenêtre ou par le toit. S'ils avaient faim ils mangeaient, ou sinon ils remplissaient leur besace et s'en allaient, non toutefois sans avoir déposé sur la table à manger ce que les porcs déposent au bord de leur auge. ... |
| Et puis quand ils passaient ... | Et puis quand ils passaient ... | ||
Version du 7 septembre ~ gwengolo 2018 à 13:52
| Dans les extraits ci-dessous Jean-Marie Déguignet (1834-1905) aborde les sujets de la misère et la pauvreté en milieu rural au 19e siècle.
Le métier de mendiant exercé entre 1844 et 1848 dans la campagne gabéricois ... Le paupérisme ... A signaler également les commentaires sur le cas Déguignet de Jean-Jacques Yvorel dans son article « Errance juvénile et souffrance sociale au XIXe siècle d’après les récits autobiographes » dans l'ouvrage collectif « Histoires de la souffrance sociale: xviie-xxe siècles » publié en 2015 aux Editions PUR. Autres lectures : « Espace Déguignet » ¤ « BABONNEAU Christophe et BETBEDER Stéphane - Mémoires d'un paysan bas-breton Tome 1 » ¤ |
1 Présentation
2 Textes
Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher
|
Pages 68-70 de l'Intégrale des Mémoires d'un paysan bas-breton :
|
Pages 86-89 de l'Intégrale des Mémoires d'un paysan bas-breton :
|
3 Annotations
Certaines références peuvent être cachées ci-dessus dans des paragraphes ( § ) non déployés. Cliquer pour les afficher : § Tout montrer/cacher
- Bazh-vanal, sf. : littéralement "bâton de genêt". Nom breton de l'entremetteur(se) qui arrangeait les mariages dans les campagnes et qui portaient symboliquement un bâton de genêt. [Terme BR] [Lexique BR] [Ref.↑]
- Avoir, verbe : souvent en remplacement du verbe être : « elle croyait qu'au lieu de mendier j'avais resté jouer » (Déguignet, IT, p 69). En breton le verbe « bezañ » (être) peut aussi prendre le sens de « avoir » en fonction de la préposition qui suit, d'où les confusions en français entre les deux verbes. De plus la forme passive est très usitée en breton où on exprime le résultat de l'action plutôt que son déroulement. [Terme BR] [Lexique BR] [Ref.↑]
- Penn-bazh, sf : bâton de marche qui servait d'arme à l'occasion. Littéralement bout de bâton, désigne le gourdin, à la fois utilitaire, défensif et décoratif qui ne quittait jamais les paysans cornouaillais dans leurs déplacements au 19e siècle. Taillé dans le buis, il présentait à l'une des extrémités un gros nœud de bois garni de clous et à l'autre bout, une lanière permettant de le faire tourner. [Terme BR] [Lexique BR] [Ref.↑]
- Lord Seymour (1805-1859), qui introduisit en France le jet de confetti, fut baptisé Milord l'Arsouille par les parisiens, à cause de son exentricité. [Ref.↑]
- Pennty, penn-ti : littéralement « bout de maison », désignant les bâtisses, composées généralement d'une seule pièce, où s'entassaient avec leur famille les ouvriers agricoles et journaliers de Basse-Bretagne (Revue de Paris 1904, note d'Anatole Le Braz). Par extension, le penn-ty est le journalier à qui un propriétaire loue, ou à qui un fermier sous-loue une petite maison et quelques terres, l'appellation étant synonyme d'une origine très modeste. [Terme BR] [Lexique BR] [Ref.↑ 5,0 5,1 5,2]
|
Thème de l'article : Écrits de Jean-Marie Déguignet Date de création : Septembre 2018 Dernière modification : 7.09.2018 Avancement : |