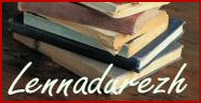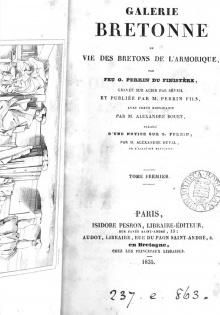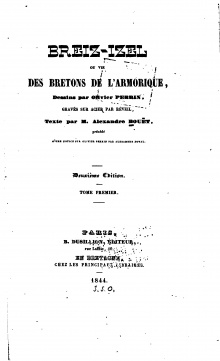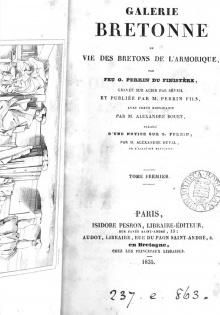 | | Edition de 1835 |  |
|
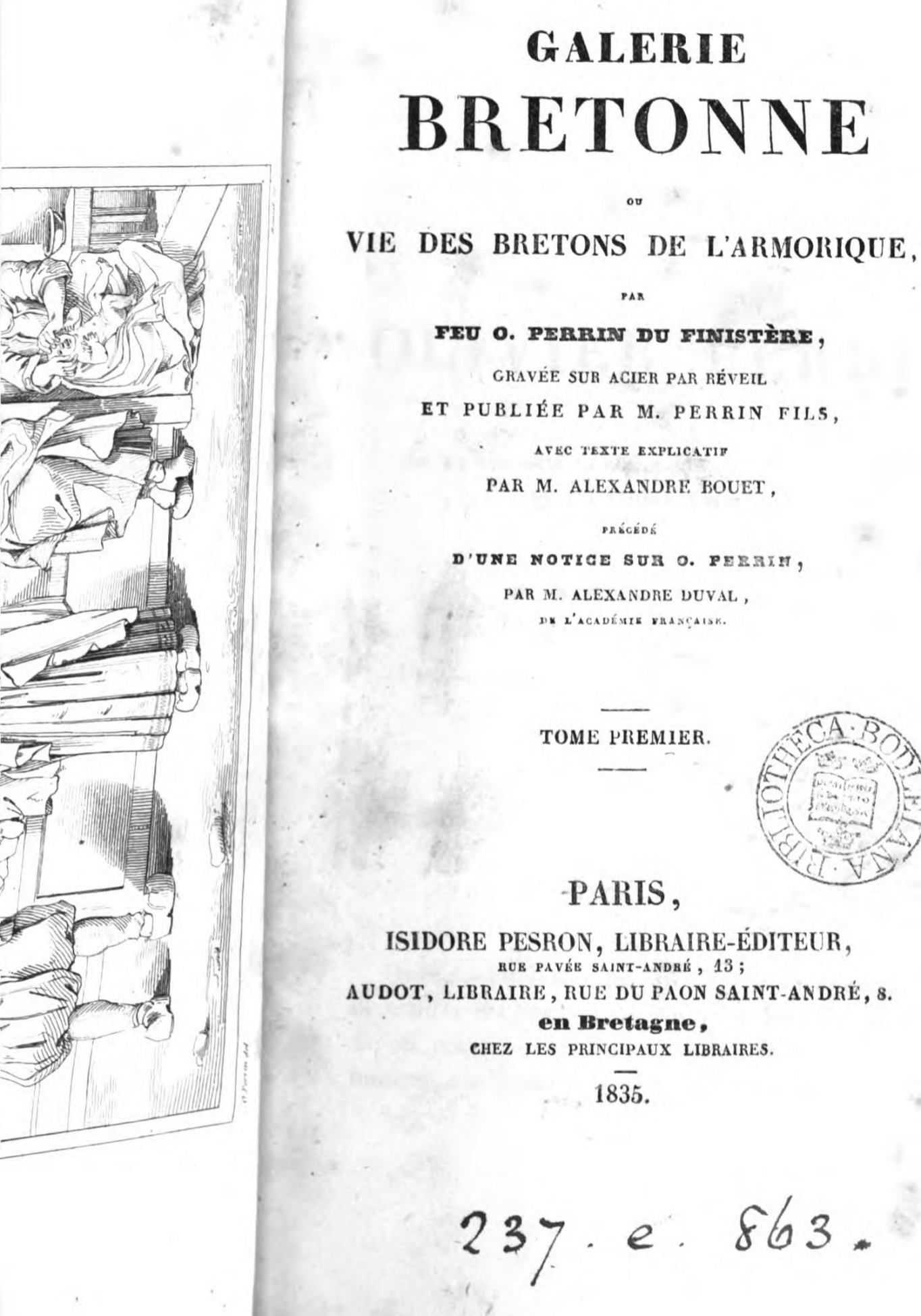
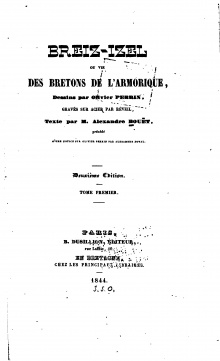 | | Edition de 1844, Tome I |  |
|
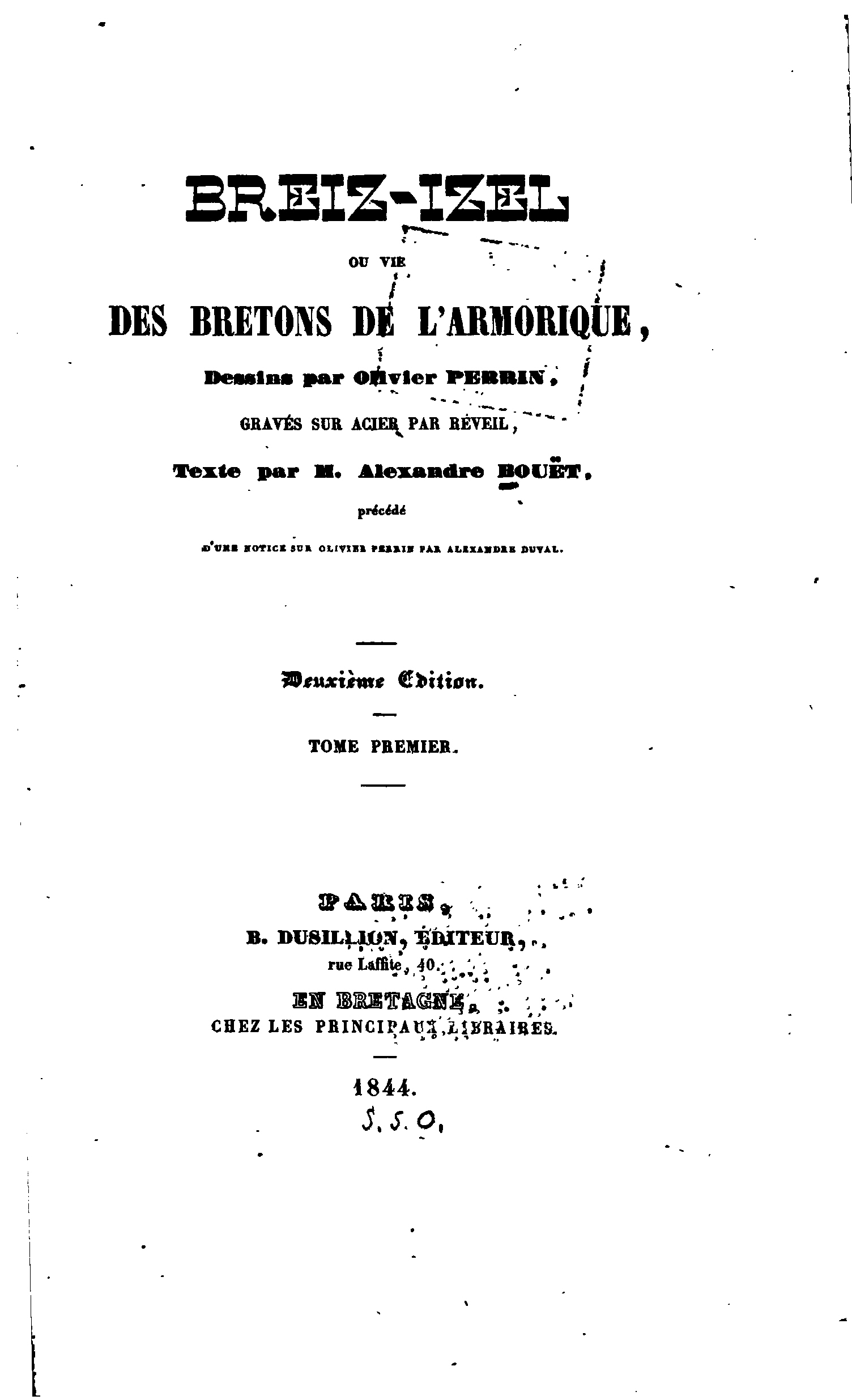
| Voici la présentation par Francis Favereau de cet ouvrage, dont la 1ère édition du tome 1 date de 1835 (et non de 1838) :
| Ouvrage essentiel et majeur du 19e siècle, celui d'Alexandre Bouët, Breiz-Izel ou la vie des Bretons d'Armorique, de 1838, illustré par le célèbre Olivier Perrin (originaire du Rostrenen révolutionnaire, devenu professeur de dessin à Quimper). Il s'agit, à travers l'itinéraire du jeune Breton Corentin, petit paysan en bragou-bras et au penn-bazh de rigueur (dès qu'il fut devenu pâtre en culotte vers ses cinq ans), comme tout un chacun alors au beau pays de Cornouaille, de suivre la vie quotidienne de la Bretagne rurale, d'étape en étape (baptême, premiers pas, confession, moisson, lutte, pardon, soule, veillée, repas de noce, etc...), dans une sorte de fresque rustique qui nous mènera de sa naissance à la mort du grand-père. Le trait est souvent rude, et le portrait peut être fort peu flatteur, mais n'était-ce pas la rudesse d'une population elle-même rude, voire dure (dixit Yves Le Gallo), et les traits d'une civilisation paysanne, à la fois celtique d'origine et catholique d' inspiration, aux antipodes mêmes des moeurs d'un journaliste bourgeois, comme l'était A. Bouët ? Sa conclusion est éloquente : "Nous avons montré dans Corentin, son père, son grand-père et ceux qui les entouraient, le paysan breton à tous les âges et sous toutes les faces ; c'est un tableau complet de sa vie domestique. Puissent les idées d'amélioration que nous avons semées sur notre route porter un jour leurs fruits ! Mais surtout, en poliçant ce peuple, qu'on se garde d'altérer sa noble et forte nature ! Plutôt que d'en faire quelque chose qui ressemble à ce type de dépravation précoce qu'on appelle Gamin de Paris, ou à ces populations gangrenées des villes qui n'ont d'autre croyance et d'autre frein que le tribunal correctionnel, ah! qu'on respecte son ignorance et sa virginité ! Les fausses lumières sont pires que l'ignorance car, au lieu de guider, elles égarent !" (p. 344)
|
Autres lectures : « La légende de Torr-è-benn par un prêtre gabéricois » ¤ « 1837 - Lettre en breton de paroissiens gabéricois à leur roi Louis-Philippe » ¤
Pages 23 et 24 de l'édition de 1836 l'auteur fait une envolée lyrique sur le cri des Vénètes face à César, le "Torr-é-benn", le symbole des révoltés bretons.
| [On] retrouve chez les Bretons cette race indomptable qui a laissé dans l'histoire des souvenirs qu'expliquerait seul son caractère actuel. Ce sont leurs pères qui, au milieu des pompes de Babylone, répondaient à Alexandre leur demandant ce qu'ils redoutaient le plus sur la terre, "qu'ils n'y craignaient rien, si ce n'est la chute du ciel". Ce sont leurs pères qui, ne cédant même pas à la fureur des éléments, luttaient, nous assure-t-on, contre les tourbillons de la tempête, et, debout sur le rivage, dédaignaient de reculer devant les flots de la mer ! Aussi Rome disait-elle d'eux : Quam terribiles sunt Britones quando dicunt, torr-e-benn ! Que les Bretons sont terribles quand ils poussent leur cri de guerre, torr-e-benn (casse-lui la tête !).
|
|