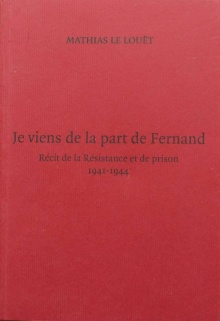LE LOUET Mathias - Je viens de la part de Fernand
Un article de GrandTerrier.
| Version du 25 juin ~ mezheven 2019 à 08:27 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 25 juin ~ mezheven 2019 à 18:52 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| {|width=870 | {|width=870 | ||
| |width=48% valign=top {{jtfy}}| | |width=48% valign=top {{jtfy}}| | ||
| - | <big>Page x-y</big> | + | <big>Page 17-21, les origines familiales et sociales</big> |
| {{Citation}} | {{Citation}} | ||
| + | Je suis né le 19 mars 1921, dans un petit penti au village de Guelen, en la commune de Briec-de-l’Odet, dans le département du Finistère. Le penti, qui veut dire en breton « un bout de maison», était une petite maison d’une ou deux pièces, où le propriétaire d’une ferme logeait une famille d’ouvriers agricoles gagée à l’année à son service. Mon père était ouvrier agricole. Ma mère, journalière agricole, n’était employée à la ferme qu’occasionnellement et surtout à l’époque des gros travaux. Mes parents élevaient une vache dans une petite étable attenante au penti et la nourrissaient à l’aide d’herbe, de foin et de pommes de terre qu’ils cultivaient sur une parcelle de terre, mise à leur disposition par le propriétaire. C’est ainsi que, pendant les trois premières années de ma vie, j’ai été élevé successivement à Guelen et Kerecun, situés tous deux sur la commune de Briec-de-l’Odet. | ||
| + | J’étais l’aîné de trois enfants dont le deuxième décéda à la naissance. J’avais trois ans lorsque mon père trouva de l’embauche, comme manœuvre, à la papeterie d’Odet (Bolloré), fabrique de papier à cigarettes, située à une dizaine de kilomètres de Quimper. Mes parents se rendirent acquéreurs d’une modeste petite maison de deux pièces et d’un petit jardin d’environ quatre cents mètres carrés situé dans le village de Lestonan, sur la commune d’Ergué-Gabéric. | ||
| + | |||
| + | En plus de ses six jours de travail hebdomadaires à la papeterie, mon père, tous les dimanches, travaillait son jardin ou, pendant l’hiver, allait abattre des talus dans les fermes environnantes pour pouvoir récupérer à son profit les souches et les branches, ce qui évitait d’avoir à acheter le bois de feu. | ||
| + | |||
| + | <spoiler id="991" text=" l’époque du foin et de la moisson ...">À l’époque du foin et de la moisson, c’était aussi des dimanches de travail dans les fermes où l’aide des ouvriers de l’usine était très sollicitée. Les seuls dimanches de repos étaient ceux où nous recevions chez nous les familles des sœurs ou du frère de ma mère 2, ou ceux où nous étions invités à notre tour dans ces familles. | ||
| + | |||
| + | Ma mère effectuait des travaux de blanchissage de linge chez les instituteurs et, à l’occasion de gros travaux, elle allait travailler en tant que journalière dans les fermes des environs. Mes parents élevaient quelques poules et lapins qui étaient un appoint à leurs modestes revenus. L’alimentation de la famille se composait essentiellement de soupe de pot-au-feu, faite pour la semaine dans un grand chaudron, de lard et de pommes de terre. Une fois par semaine, ma mère confectionnait une bouillie d’avoine dans une grande bassine de cuivre, une autre fois elle faisait des crêpes de froment et de sarrasin sur le feu de cheminée. Le dimanche, seulement, nous avions de la viande, steak ou rôti de veau, ou un lapin, ou une poule de l’élevage familial. C’était d’ailleurs l’ordinaire de presque toutes les familles. Nous n’étions pas malheureux, mais il fallait que ma mère calcule au plus juste ses dépenses ; elle tricotait, rapiéçait et raccommodait ou rallongeait les vieux vêtements pour éviter des dépenses supplémentaires. | ||
| + | |||
| + | À l’âge de sept ans, mes parents me mirent à l’école publique, la seule école du village de Lestonan, pour y. apprendre à lire, à écrire, à compter et aussi pour y apprendre le français. Ma langue maternelle était le breton. Tout le monde à Lestonan ne conversait qu’en breton. De la langue française, je ne connaissais que quelques rudiments. Cela me permit, à la rentrée scolaire, de servir d’interprète entre l’institutrice qui ne possédait pas un mot de breton et mon cousin germain qui ne connaissait pas un mot de français. | ||
| + | |||
| + | Deux ans après, M. Bolloré, le potentat de la papeterie, fit construire à ses frais, sur un terrain lui appartenant, deux écoles libres, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles. | ||
| + | |||
| + | Il mit en demeure ses ouvriers d’y inscrire leurs enfants pour la rentrée d’octobre. Un seul ouvrier refusa. Il était athée et, chose rare à l’époque, marié civilement. Il était sourd et muet. Malgré son infirmité et ses grandes qualités professionnelles, il fut licencié le jour de la rentrée scolaire. | ||
| + | |||
| + | Quant à moi, mes parents furent donc contraints de m’envoyer à l’école privée. Je n’y restai qu’un an. En effet, dans le courant de l’année, Bolloré avait acheté deux nouvelles machines et congédié un certain nombre de manœuvres, devenu personnel en surnombre. Mon père faisait partie de cette charrette de licenciés. | ||
| + | |||
| + | Après son congédiement de chez Bolloré, mon père a exercé les métiers d’ouvrier agricole, de manœuvre dans les carrières de pierre, de terrassier sur les chantiers de constructions de route. | ||
| + | |||
| + | À la rentrée d’octobre suivante, l’école publique récupéra tous les enfants des ouvriers congédiés. Je changeai de nouveau d’école. Les deux écoles publiques, de filles et de garçons, étaient maintenant dirigées par M. et Mme Lazou. Ils nous préparèrent au certificat d’études primaires et certains au concours des bourses. J’étais dans ce dernier groupe. En septembre, M. et Mme Lazou vinrent annoncer à mes parents que j’avais obtenu une bourse entière pour le lycée de Quimper où je devais entrer en internat. Mes parents hésitèrent car ils me voyaient déjà gagé comme ouvrier agricole. Devant l’insistance des deux instituteurs, ils acceptèrent. Pour eux, l’achat de mon premier trousseau fut une lourde charge qu’ils eurent du mal à assumer. | ||
| + | |||
| + | M. et Mme Lazou étaient deux pédagogues extraordinaires, doués chacun d’une grande conscience professionnelle. Ils étaient aimés, estimés et respectés de toute la population. | ||
| + | |||
| + | Une ou deux fois par semaine, M. Lazou organisait à titre bénévole des cours du soir pour les jeunes agriculteurs. Après une courte dictée et un problème d’arithmétique, il leur enseignait les procédés d’amendement du sol. J’assistais à ces cours du soir. | ||
| + | |||
| + | À l’âge de douze ans, j’entrai donc au lycée [...] | ||
| + | </spoiler> | ||
| {{finCitation}} | {{finCitation}} | ||
| + | |||
| + | <big>Page 35, Mme Lazou</big> | ||
| + | {{Citation}} | ||
| + | CHAPITRE II | ||
| + | |||
| + | Les portes de la clandestinité | ||
| + | |||
| + | Le premier trimestre s’achevait, nous étions aux vacances de Noël 1940. Mme Lazou, dont le mari capitaine dans l’armée française fut tué au combat dès les premiers jours de l’invasion allemande, vint me voir chez mes parents et me demanda de l’accompagner chez elle pour y rencontrer Malou, sa fille, et son gendre, René Le Herpeux, tous deux étudiants en médecine à Rennes. Le long du bref chemin qui séparait notre habitation de l’école, elle me demanda si je voulais bien faire partie d’un mouvement appelé le Front national 1 et distribuer des tracts et journaux clandestins. À Mme Lazou, pour qui j’avais une admiration sans borne et une profonde reconnaissance, je n’aurais rien su refuser. Cela aurait été pour moi inconcevable. Je lui répondis par l’affirmative mais objectai cependant que je n’étais pas communiste, que je souhaitais une collaboration de classes. Ce dont je ne m’ouvris pas à elle, c’est du fait que j’étais croyant. Elle le savait, d’ailleurs. J’avais été élevé dans la religion catholique. Depuis ma première communion, à l’âge de douze ans, je n’allais plus guère à la messe qu’une fois par an, à Pâques - c’était une tradition-, mais je restais croyant. Or, pour moi, le fait d’être croyant et celui d’être communiste étaient incompatibles. Je n’avais pas aimé non plus, avant-guerre, les chants bruyants de ceux qui revenaient en car de fêtes communistes et qui entonnaient à leur retour L’Internationa1e, les poings levés. Et puis que savais-je du marxisme ? Mon livre de philo au lycée, le Cuvelier, y consacrait cinq ou six lignes. Mme Lazou eut la délicatesse de ne pas me contredire. Mes sentiments antiallemands et anti-pétainistes lui suffisaient. | ||
| + | |||
| + | {{FinCitation}} | ||
| |width=4% valign=top {{jtfy}}| | |width=4% valign=top {{jtfy}}| | ||
| |width=48% valign=top {{jtfy}}| | |width=48% valign=top {{jtfy}}| | ||
| - | <big>Page x-y</big> | + | <big>Page 32 et 35-37, mot de passe et arrestation</big> |
| {{Citation}} | {{Citation}} | ||
| + | À partir de ce moment-là, Mme Lazou et moi-même ne reçûmes aucune visite d’agents de liaison. J’étais coupé de tout contact à l’exception de ceux que j’avais établis avec une jeune professeur de Concarneau, Mlle Lucas et un employé de la préfecture, Roguès, Mais nous n’avions aucun lien avec l’échelon supérieur. Il fallut attendre les vacances de Noël pour demander à René Le Herpeux, le gendre de Mme Lazou, de rétablir un nouveau contact. René Le Herpeux décida de m’envoyer un agent de liaison pour me mettre en relation avec un responsable régional. Nous convînmes d’un lieu de rendez-vous, chez Mme Lazou, et d’un mot de passe : « Je viens de la part de Fernand.» J’attendis le rendez-vous pendant deux mois. | ||
| + | <hr> | ||
| + | Le 1er mars 1943, un gars se présenta chez Mme Lazou et demanda à me voir. Mme Lazou lui dit que je ne serais rentré de mon travail que vers dix-neuf heures. Jusqu’alors elle logeait les agents de liaison. Je leur apportais un deuxième vélo à Quimper et ils me suivaient jusqu’à Lestonan. Cette fois le gars prétexta un rendez-vous à Quimper et dit qu’il ne pouvait m’attendre. Comme je devais commencer mon travail à neuf heures aux Ponts et Chaussées, il me fixa rendez-vous le lendemain à huit heures dans le hall de la gare de Quimper. Je devais fumer une cigarette, tenir un ticket de chemin de fer à la main et lire une revue peu courante, dont je ne me souviens plus du titre. À l’heure dite j’étais au rendez-vous, la cigarette aux lèvres, le ticket de chemin de fer à la main et lisant la revue. Un gars d’une trentaine d’années, vêtu d’un blouson et d’un pantalon de golf, coiffé d’un béret et chaussé de gros brodequins s’approcha. Il me demanda du feu et, après qu’il eut allumé sa cigarette, me dit : « Je viens de la part de Fernand.» C’était le mot de passe convenu. Nous nous dirigeâmes vers la sortie. Dans la cour de la gare il me présenta à un autre gars correctement vêtu de bleu marine, et me dit que ce serait désormais mon nouveau responsable régional. Je ne me souviens plus des prénoms qu’ils se donnèrent. Nous allâmes à pied vers le centre-ville. Tous deux me questionnèrent sur les possibilités de faire redémarrer l’organisation et de la développer. Ils me parurent bien renseignés sur nos activités passées. Je racontai que je n’étais plus qu’en contact très épisodique avec un gars de la préfecture, une prof de Concarneau mais que j’avais la possibilité de recruter trois autres gars à Ergué-Gabéric. Ils me demandèrent alors de faire marcher tout de suite la ronéo. Le responsable régional m’aurait apporté un stencil dans les jours à venir. Je leur répondis que la ronéo n’était plus à Lestonan, que j’ignorais même où elle était. Ils insistèrent pour que je la récupère au plus vite. Je leur assurai que ce serait fait dès qu’un ami, agent du génie rural, pourrait, pour son travail, retourner là où il l’avait transportée. | ||
| + | <spoiler id="992" text="Tout en marchant et bavardant ...">Tout en marchant et bavardant, nous étions arrivés place Toul-al-Laër et nous entrâmes boire un café au « Central ». À neuf heures moins cinq je leur dis qu’il était temps que j’aille au bureau. Nous convînmes d’un nouveau rendez-vous pour après le déjeuner, à treize heures, rendez-vous auquel je me serais fait accompagner par le gars de la préfecture. Je fixai le lieu de rencontre au bout de la rue Kéréon. Comme ils ne savaient pas où se trouvait cette rue, nous nous dirigeâmes vers la place SaintCorentin. Nous étions arrivés devant le commissariat de police qui se trouvait alors place Laënnec lorsque je leur désignai du doigt le bout de la rue Kéréon, en face du porche de la cathédrale. À cet instant précis, l’homme au pantalon de golf me saisit les deux poignets et me dit : « Finie la comédie ! » L’autre me palpa tout du long du corps, à la recherche d’une arme éventuelle. Ils me bousculèrent alors vers le commissariat où je tombai à quatre pattes à la suite d’un croche-pied ou après avoir heurté une marche d’accès. J’avais eu affaire à deux flics et non à deux membres de l’organisation clandestine. | ||
| + | <spoiler> | ||
| {{finCitation}} | {{finCitation}} | ||
| |} | |} | ||
Version du 25 juin ~ mezheven 2019 à 18:52
| ||||||||||||||||||||||||||
Notice bibliographique
|
Dans ce livre édité par sa veuve Jacqueline, Mathias Le Louët (1921-1987) raconte ses souvenirs d'enfant de Briec et Lestonan et de jeune adulte entré dans la résistance. Autres lectures : « KERBAUL Eugène - Militants du Finistère (1918-1945) » ¤ « Les résistants communistes d'Ergué-Gabéric en 1939-45 » ¤ « MAITRON Jean - Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social » ¤ « Jean et Francine Lazou, instituteurs de 1926 à 1950 » ¤ « KERGOURLAY Guillaume - Le pays des vivants et des morts » ¤ « Souvenirs d'enfance de fin de guerre 1939-45, par Michel Le Goff » ¤ | |||||
Extraits
|
Page 17-21, les origines familiales et sociales
Page 35, Mme Lazou
|
Page 32 et 35-37, mot de passe et arrestation
|